
Le combat d’Henry Sidambarom
Henry Sidambarom, né le 5juillet 1863 à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) et mort le 21 septembre 1952, est un homme politique guadeloupéen. Juge de paix du canton de Capesterre-Belle-Eau et fils d’immigrants tamouls, il défendra toute sa vie les Guadeloupéens d’origine indienne face au racisme et à une véritable discrimination d’Etat.
Petit point historique
Après l’abolition de l’esclavage en 1848 dans les colonies françaises, la majorité des esclaves déserte les plantations. Les grands propriétaires terriens, les anciens « maîtres », ont besoin de main d’œuvre. C’est la période de « l’engagisme ». Indiens, mais également Africains et Chinois, sont recrutés sous contrat et débarquent dans le nouveau monde.
Les premiers Indiens arrivent le 6 mai 1853 à Saint-Pierre en Martinique, et le 23 décembre 1854 en Guadeloupe, après des traversées en bateau souvent effroyables et marquées par une forte mortalité. En effet, a la recherche d’un eldorado, ils ont trouvé le servage…
Les premiers engagés

Le 6 mai 1853, les 300 premiers engagés indiens des Antilles débarquent dans la rade de Saint-Pierre. Bercés par des espoirs de vie meilleure, 25 000 de leurs compatriotes les rejoindront sur « l’île aux fleurs », 42 000 iront en Guadeloupe et plusieurs milliers en Guyane durant les quatre décennies suivantes. Ce sont eux, travailleurs indiens libres recrutés pour des contrats de cinq ans, qui sont chargés de remplacer les esclaves libérés en 1848 dans les champs de canne à sucre. Maltraités par les propriétaires des plantations, diabolisés par les prêtres catholiques, méprisés par les « nouveaux citoyens » noirs, ces « coolies » (dérivé du turc « köle » qui signifie « esclave »), comme on les surnomme alors avec dédain, sont une main-d’œuvre docile et bon marché.
Beaucoup d’ailleurs n’y survivront pas. La majorité finira par déserter les plantations, comme leurs prédécesseurs, les esclaves noirs.
Le mensonge
Dans la tradition hindoue, l’océan, c’est le Kala Pani, l’espace tabou à ne pas franchir »
Jean Samuel Sahaï, auteur d’Adagio pour la Da. Les Indiens des Antilles de Henry Sidambarom à Aimé Césaire (Atramenta, 2013).
Alors, pour rassurer les candidats au départ, les « mestrys », des agents spécialisés dans le recrutement d’engagés indiens, promettent monts et merveilles après un voyage qu’ils assurent rapide et confortable. Parfois, quand ils ne parviennent pas à calmer les réticences, ils kidnappent, droguent, saoulent… Car les propriétaires de plantations veulent toujours plus de bras. « Les Indiens sont réputés dociles », souligne Sahaï. Plus que les engagés précédents, Chinois, Japonais et Français.
Jusqu’au 10 août 1861 du moins. A cette date, les deux puissances coloniales signent un traité autorisant les embauches par les Français d’Indiens sous domination anglaise. La raison est avant tout économique : pour les Britanniques, un émigrant pour les Antilles, c’est un sujet de moins à nourrir au moment où une famine sévit depuis un an dans les provinces de Madras et du Nord.
Définies par le traité franco-anglais, les conditions de vie des engagés sur les bateaux sont contrôlées par un agent britannique avant le départ. Un second les attend de l’autre côté du globe, pour surveiller les conditions de travail. Ces Indiens faisant voile vers les colonies de la République française n’en restent pas moins des sujets sous la « protection » de Sa Majesté. Les abus sont pourtant légion. « Ceux qui débarquèrent aux îles à sucre, candides, allaient devoir subir l’oppression des maîtres colons », écrit Jean Samuel Sahaï dans son livre.
Logés dans les bâtiments auparavant réservés aux esclaves, victimes d’abus physiques, les coolies qui pensaient trouver un eldorado de libertés rencontrent une nouvelle forme de servage. En Martinique, près de 40 % des engagés, fatigués, déçus, profitent du billet retour garanti pour ceux ayant honoré le contrat. Pour les autres, il ne reste que la révolte. Un conseiller général à Pointe-à-Pitre remarque ainsi : « Ils mettent le feu afin d’être envoyés à Cayenne, où ils espèrent, en subissant leur peine, trouver tout à la fois, repos et bonne nourriture. »
Le mépris
Mauvais locuteurs, adeptes de coutumes jugées sataniques, les engagés font aussi l’objet de mépris. Les anciens esclaves les accusent d’encourager les basses rémunérations en acceptant une paye de 12,50 francs par mois, quatre fois moins que les prétentions salariales des anciens esclaves. Quant au mot « coolie », il est associé à des proverbes dégradants, à l’image de « Faible kon an coulie ». Le terme de coolie dalot désigne les balayeurs de rue : en Martinique, ce travail était confié aux Indiens n’ayant pas pu embarquer dans le dernier convoi de retour, en 1900, afin d’éviter qu’ils deviennent des mendiants dans les rues de Fort-de-France.
Le combat
Honnis par tous, incluant l’Etat qui avait encouragé leur venue, les Indiens et leurs descendants, même nés aux Antilles, n’ont pas droit à la nationalité française. Ils ne peuvent pas voter et faire le service militaire, haut lieu d’insertion socio-professionnelle à l’époque. Henry Sidambarom n’aura de cesse de se battre contre cette injustice, jusqu’à ce qu’il obtienne gain de cause.
Ce sera fait le 21 avril 1923, jour où les Guadeloupéens d’origine indienne acquièrent officiellement la nationalité française, par le gouvernement de la IIIe République. L’année suivante, la citoyenneté française et les droits civiques afférents sont élargis à tous les descendants d’Indiens des Outre-mer français.
Dans son livre, souvent entrecoupé d’intermèdes poétiques inspirés de la musicalité créole, d’où le titre « Adagio… », Jean Samuel Sahaï revient sur l’itinéraire d’Henry Sidambarom et des Indiens des Antilles. Il consacre aussi de nombreuses réflexions à Aimé Césaire et à son « indianité », rappelant que la « Da » du jeune Aimé, sa nourrice, était d’origine tamoule.
Hommage
En 1981, lors de l’officialisation du jumelage entre Pondicherry et Basse-Terre, un hommage est rendu à Henry Sidambarom :
-inauguration de l’avenue Sidambarom à Basse-Terre
-une stèle à Fonds-Cacao à Capesterre-Belle-Eau
-naissance du Comité Henry Sidambarom, officialisé en 1988
En 2013, le Prix Félix Éboué lui est consacré dans le cadre du 150e anniversaire de sa naissance . Un buste à son effigie sera posé à Karikal (Inde). En décembre 2013, l’Ambassadeur de l’Inde, Shri Arun K. Singh, assiste à l’invitation du Comite Henri Sidambarom, aux célébrations organisées pour fêter le 150e anniversaire de la naissance de Henri Sidambarom.
Sources:
-Wikipédia
-GEO
-France info outre-mer
-Adagio pour la Da de Jean Samuel Sahaï
-La panse du chacal de Raphaël Confiant
Vous aimerez aussi
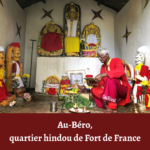
Au-Béro: quartier hindou de Fort de france
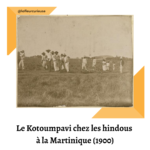
Le kotoumpavi
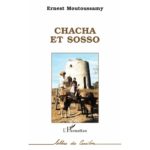
Chacha et Sosso
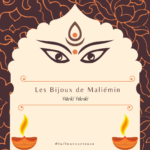
Les bijoux de Maliemin
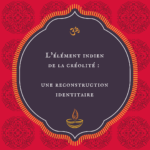
L’élément indien de la créolité: une reconstruction identitaire
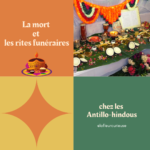
La mort et les rites funéraires chez les antillo-hindous
Un commentaire pour “Le combat d’Henry Sidambarom”
Laissez un commentaire
Mon Instagram
N`oubliez surtout pas que notre langue maternelle respecte les mêmes codes que nos langues ancestrales africaines (philosophie, mathématique, vibration, etc) Ne croyez surtout pas que c`est juste une déformation banane du français à la sauce arachide de l`Afrique. Sé sa yo lé zot kwè pou pa zot konprann nannan-an!
La preuve, on l`utilise seulement pour exprimer nos fortes émotions...mais le reste ? Ou pire, nous transformons notre langue au profit du français par méconnaissance. Mi la sa danjéré menm !
Prenez le temps de respecter la création de notre verbe. Il y a toujours une première, une deuxième et une troisième lecture....
#fokousav #kreyol






Merci pour cet article et qui remet en lumière les conditions des engagés indiens qu’on a tendance à oublier. Je ne connaissais pas cet figure historique des antilles.